- Mieux comprendre les normes
- cordes, corde
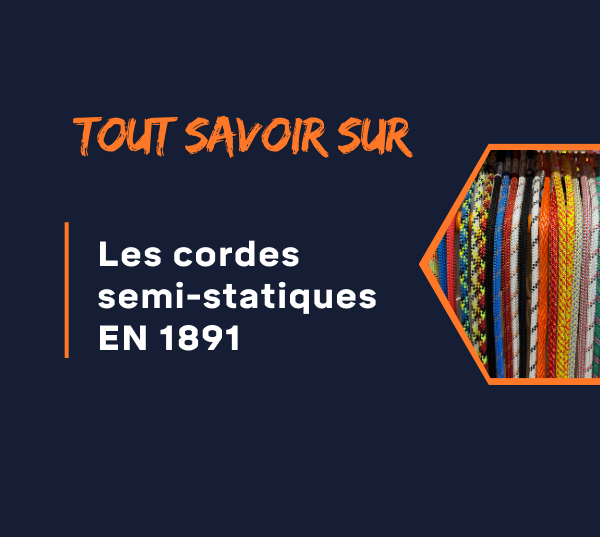
Les cordes semi-statiques EN 1891
Généralités sur les cordes de sécurité
Il existe sur le marché 2 types de corde de sécurité
Les cordes dynamiques :
-Les cordes dynamiques ont été spécialement développées pour la pratique de l’escalade et de l’alpinisme. Elles possèdent une réserve d’élasticité suffisante pour absorber l’énergie de plusieurs chutes de facteur 2. Elles sont régies par la norme EN 892.
Du fait de leur grand allongement statique (c’est-à-dire sous le poids de 80kg, sans aucune chute), elles ne sont pas adaptées au travail en hauteur et ne sont réservées qu’aux loisirs et à dans de rares cas, au secours en montagne. En effet une corde dynamique s’allonge tellement au moment d’une chute que l’opérateur ne peut maitriser son tirant d’air. Cette incertitude est dangereuse dans le cadre du travail en hauteur et l’usage d’une corde semi-statique (appelé aussi support d’assurage flexible) et d’un système antichute ont été préférés dans le monde du travail.
Les cordes semi-statiques :
-Les cordes semi-statiques ont historiquement été mises au point pour la spéléologie.
En effet, ces derniers descendent et remontent sur ces cordes et ont besoin d’un faible allongement (maximum 5% d’allongement sous 50/150kg) pour éviter l’effet yoyo, ils Ces cordes semi-statiques sont encadrées par la norme EN 1891.
Elles sont devenues au fil du temps, les cordes pour les cordistes et les travaux en hauteur.
Ces cordes peuvent être aussi appelées cordes statiques ou encore « stat’ », mais ces termes sont totalement erronés, car une corde statique ne peut être une corde de sécurité (c’est-à-dire avec une norme). En effet une corde de sécurité doit avoir un minimum d’allongement ou d’élasticité.
Il existe pourtant des cordes statiques, mais elles ne sont pas normées pour assurer la sécurité d’une personne et la plupart du temps ne servent que pour le levage ou la manutention (comme les cordes de rétention ou de démontage en élagage)
On peut également trouver des cordes toronnées qui peuvent être aussi utilisées en travaux en hauteur. En fait ce sont des supports d’assurage, elles ne sont pas normées EN 1891 mais longes EN 354 ou longes EN 358 et EN 353 si elles sont indissociables d’un antichute mobile parfaitement adapté à ces cordes. Ces solutions disparaissent lentement du marché au profit des cordes tressées EN 1891 même pour les longes et autres utilisations de sécurisation des personnes.
La construction des cordes semi-statiques EN 1891
Les cordes semi-statiques normées EN 1891 sont toutes composées d’une âme et d’une gaine.
L’âme de la corde :
L’âme, c’est ce qui est à l’intérieur et qui fait la majorité de la résistance de la corde (à l’exception des cordes d’élagage qui ont une construction très particulière).
Cette âme est toujours en polyamide à l’exception des cordes d’élagage qui sont un polyester. Cette matière qu’on appelle aussi communément Nylon, est la seule matière capable d’avoir une très grande résistance alliée à un bon allongement.
L’âme selon les fabricants, peut être tressée en une seule ou plusieurs tresses, mais peut aussi être composée de plusieurs petits torons de polyamide, appelés autrement câblés.
Gaine couleur + Ame câblées
La gaine de la corde :
La gaine, elle, est toujours tressée avec le fil plus ou moins épais et de différentes couleurs selon l’usage pour lequel est destiné la corde. C’est la gaine qui protège l’âme de la friction et des agressions.
La norme exige un minimum de 30% d’épaisseur de gaine pour assurer une protection minimum de l’âme.
Cette gaine est en polyamide, mais certaines peuvent être en polyester.
Avantages du polyamide :
-touché lisse
-très bon allongement
Avantages du polyester :
-bonne résistance aux UV
-faible rétraction à l’humidité
Comportement des cordes semi-statiques
Lors de la fabrication des cordes semi-statiques, les fabricants mettent un apprêt sur les fils composants la gaine afin de faciliter leur passage dans les différents guides des machines à tresser. C’est une sorte de lubrifiant.
Cet additif rend glissant la corde lors des premières utilisations. Vous pouvez être surpris lors de son premier usage notamment si vous utilisez un frein déjà un peu usé.
Pour solutionner ce problème il faut rincer la corde à l’eau en la laissant tremper 24H, la rincer et la sécher ensuite loin d’une source directe de chaleur et du soleil.
Les cordes semi-statiques et l’humidité :
La problématique :
Etant donné leur construction majoritairement en polyamide, il est important de rappeler le comportement du polyamide à l’usage et ses conséquences.
Le polyamide, s’il s’allonge très bien, a comme inconvénient de se rétracter à l’usage notamment en présence d’humidité (il y en a beaucoup dans l’air), et voici les conséquences :
-si le polyamide se rétracte, cela entraine une variation de sa longueur et la corde va se raccourcir (jusqu’à 10%), ce qui peut poser un problème si elle a été coupée à une longueur précise. Par conséquent la tremper avant la découpe est une solution.
-si le polyamide se rétracte, le diamètre de la corde va également grossir légèrement et donc changer vos sensations ou coulissement dans le passage des différents appareils de sécurité utilisés. Dans tous les cas contrôlez toujours bien sur la notice et sur le terrain que votre corde est compatible avec vos appareils, notamment l'antichute mobile sur corde et le descendeur.
-la rétraction du polyamide affecte également la souplesse des cordes semi-statiques, elles deviennent dures à manipuler et à plier, par conséquent elles sont aussi de moins en moins aisées à nouer dans le temps. Si vous laissez vos cordes d’accès semi-statiques sur une falaise par exemple, les nœuds laissés en place vont durcir et deviendront indénouables.
-pour finir, une corde qui se rétracte à l’humidité aura un allongement supérieur à l’allongement d’origine.
En résumé, le durcissement d’une corde semi-statique majoritairement fabriquée en polyamide est inéluctable. En revanche une corde semi-statique qui durcit est une corde qui résistera mieux à l’abrasion dans le temps. C’est sa rigidité qui permettra l’amélioration de cette performance.
Les solutions :
- rétracter la corde avant son usage pour obtenir la longueur souhaitée (mais ce n’est pas toujours possible) ou d’acheter une corde plus longue d’au moins 10% que la longueur dont vous avez besoin.
-utiliser un diamètre de corde inférieur à 11mm
-certains fabricants utilisent une gaine en polyester qui se rétracte moins à l’humidité.
-d’autres encore, mettent en place une technologie spécifique qui rend solidaire l’âme et la gaine afin de limiter la rétraction de la corde et ainsi modérer les conséquences néfastes de cette rétraction : elle gonfle moins, la corde conserve plus longtemps sa souplesse et sa longueur : Cordes Beal Unicore, cordes Courant Mythic.
La couleur des cordes semi-statiques :
Pourquoi y a-t-il des cordes semi-statiques de couleurs différentes ?
Si les fabricants ont développé des couleurs de cordes c’est d’abord pour les différencier.
En effet un cordiste doit toujours évoluer avec 2 cordes : une, dite « de travail » sur laquelle il va se déplacer à la montée comme à la descente et une seconde qui assurera sa sécurité en cas de rupture de la première voir de permettre son sauvetage.
La corde de travail, va s’user beaucoup plus vite à cause du mordant des bloqueurs et de la chaleur générée par la vitesse des appareils au moment des descentes rapides.
Par conséquent il peut être judicieux de consacrer toujours la même corde à cet usage pour conserver la corde de sécurité en meilleur état possible.
Corde semi-statique avec une gaine couleur Beal
Les cordes pour les travaux en hauteur spéciaux
L’activité de cordiste va vous amener à travailler sur des chantiers dans des environnements spécifiques à prendre en ligne de compte lors du choix de votre équipement.
Les fabricants ont su répondre à ces diverses spécificités :
Environnement en présence de produits chimiques :
Le polyamide et dans une moindre mesure le polyester sont très sensibles aux produits chimiques. En revanche l’aramide lui, l’est beaucoup moins. Certains fabricants ont pu doubler la gaine en incluant dans la corde une seconde couverture en aramide, afin d’améliorer la résistance de la corde aux produits chimiques.
Ame en polyamide + couverture en aramide+ gaine en polyamide de la corde Beal Hot Line (illustration Beal)
Environnement très proche d’une source de chaleur intense :
Le polyamide et le polyester ont respectivement un point de fusion de 180° et 255° ce qui est très bas comparé à une source de chaleur telle qu’un chalumeau, soudure à l’arc ou conduite de vapeur…
L’aramide lui, à un point de destruction (il ne fond pas) à 500°.
Certains fabricants ont donc développé des cordes avec une gaine plus ou moins épaisse, composée d’aramide capable de résister à une charge élevée même si le polyamide, lui, a complétement fondu !
Gaine aramide « Technora » + âme en polyamide Corde Beal Raider 11mm (illustration Beal)
Environnement proche de l’eau, comme le travail sous les plateformes pétrolières ou les ponts :
Le polyamide ou le polyester composant les cordes semi-statiques ne permet pas à ces dernières de flotter et le surplus de corde trempant dans l’eau peut s’emmêler dans des branches, voire pire, être emmené par l’hélice du bateau de surveillance.
Certains fabricants ont su développer des cordes semi-statiques EN 1891 flottantes comme la corde Beal Pro-Water 11mm avec jonc en néoprène au milieu de l’âme polyamide.
Gaine orange fluo + collage de l’âme avec Unicore + jonc central en néoprène (illustration Beal)
Comment sont testées les cordes semi-statiques selon l’EN 1891 ?
Les cordes semi-statiques sont régies par la norme EN 1891 très précise, qui réalise de très nombreux tests. Les résultats de ces tests sont obligatoirement inscrits sur la notice d’emploi du fabricant et par chance une partie de ces tests sont de bons critères pour vous aider à choisir votre matériel.
Il existe 2 types de cordes semi-statiques, les cordes de type A et les cordes de type B :
Type A :
Corde de sécurité à utiliser en spéléologie, en secours, dans les travaux en hauteur. Dans ce dernier cas elle est utilisée pour l’accès au lieu de travail, en combinaison avec d’autres appareils, ou pour effectuer des travaux de tension ou en suspension sur la corde.
La corde de type A respecte aussi souvent l’exigence de la norme EN 353 – 2 (Antichute mobile) demandant une résistance du support flexible de 2200kg pour une corde.
La norme EN 12841 recommande également l’usage d’une corde de type A.
Type B :
Corde de diamètre et de résistance généralement plus faibles que celle de type A, requérant davantage de précautions et d’attention. Il est nécessaire de vérifier notamment sur la notice d’emploi des appareils mécaniques qu’ils fonctionnent bien avec des cordes de diamètre faibles.
|
Différence de test en type A et B
|
Type A |
Type B |
|
Poids utilisés pour les tests |
100kg |
80kg |
|
Nombre de chutes facteur 1 |
mini 5 chutes |
mini 5 chutes |
|
Force de choc facteur 0,3 |
maxi 600 kg |
maxi 600 kg |
|
Résistance statique |
2200kg |
1800kg |
Mesure de l’allongement statique
La norme EN 1891 impose que l’allongement maximum soit de 5% avec une charge progressive de 50kg à 150kg.
Comment est mesuré l’allongement statique selon la norme EN 1891 ?
-On place une masse de 50kg sur un brin de 1 mètre de corde pendant 5mn, puis on alourdit cette masse jusqu’à 150kg également pendant 5mn, puis on mesure la corde.
-La corde ne doit pas avoir un allongement supérieur à 5%.
Ce test est censé reproduire l’allongement sous l’effort d’un opérateur qui remonte le long de sa corde à l’aide de bloqueurs.
Quand peut-on avoir besoin d’un faible allongement ?
-On peut avoir besoin d’un faible allongement lors de grandes remontées sur corde, car plus on a de longueur de corde déployée, plus on ressent l’effet yoyo. Par conséquent, plus l’allongement sera faible, plus on évite l’effet yoyo, moins on aura besoin d’énergie pour remonter sur la corde.
Mesure du poids de la corde
Pourquoi le poids d’une corde de 50m (par exemple) ramené au mètre est toujours plus lourd que le poids au mètre indiquée par le fabricant ?
Comment est mesuré le poids d’une corde selon la norme EN 1891 ?
-une masse de 100kg est placée sur une longueur de corde de 1 mètre, pendant un temps limité. Enfin on pèse séparément l’âme et la gaine.
La limite de ce test :
On comprend que le test donne un résultat assez éloigné du poids de la corde au repos. Par conséquent le poids indiqué par le fabricant, qui est une valeur imposée par celle trouvée en laboratoire lors de la certification, sera toujours inférieur à celui constaté par l’opérateur.
Alors comment choisir une corde légère ?
Le test a cela d’utile, c’est qu’il rend équitable la comparaison du poids entre chaque corde, indépendamment de leur souplesse ou allongement au repos. Donc pour choisir la corde semi-statique, comparez-la aux autres d’après ce critère de poids noté obligatoirement sur la notice d’emploi.
Mesure de la nouabilité
Ce test mesure la souplesse de la corde, notamment pour connaitre sa facilité à être nouée.
Comment est mesurée la nouabilité selon la norme EN 1891 ?
-On fait un nœud simple sur une brin de corde de 3 m suspendu avec une masse statique de 10kg.
Après 60 secondes de suspension on insère dans le nœud un cône calibrée et on mesure sa profondeur de pénétration.
La largeur maximum de l’œil du nœud ne pourra pas excéder 12mm.
La limite de ce test :
La limite de ce test est qu’il est effectué avec une corde semi-statique neuve. Or on sait qu’en vieillissant une corde semi-statique se rétracte à l’humidité, devient plus rigide et donc moins aisée à nouer.
Mesure du glissement de gaine d’une corde
Ce test mesure le glissement entre l’âme et la gaine. En effet les appareils utilisés, notamment les descendeurs peuvent tirer la gaine et donc générer un glissement de la gaine qui vient s’accumuler en un endroit, bloquant l’opérateur dans sa progression.
Comment est mesuré le glissement de gaine sur l’âme d’une corde selon la norme EN 1891 ?
-On utilisera un brin de corde semi-statique de 2,25m long, que l’on placera dans une sorte de court tunnel.
Dans ce tunnel 3 contraintes de 5kg chacune lui seront appliquée sur toute sa périphérie. Toute la longueur de la corde coulissera dans tunnel et le glissement de gaine ne devra pas excéder pour une corde semi-statique de typa A 1% et 1.5% pour une corde de type B.
La limite de ce test :
La limite de ce test est qu’il est effectué avec une corde semi-statique neuve et sèche. Or on sait qu’en vieillissant une corde semi-statique se rétracte à l’humidité, limitant ainsi le glissement de la gaine sur l’âme.
Par ailleurs, la plupart des fabricants ont développé des méthodes de production, voir des technologies (collage de la gaine sur l’âme) pour limiter ce glissement de gaine.
Attention : une corde semi-statique très humide, si elle n’a pas sa gaine collée, aura un fort glissement de gaine au moment de la descente.
Mesure de la résistance de la corde semi-statique :
Ce test mesure la résistance statique d’une corde jusqu’à sa rupture.
Comment est mesuré la résistance d’une corde selon la norme EN 1891 ?
Les 2 extrémités de la corde sont enroulées sur ce qu’on peut décrire comme de petits cors de chasse.
La résistance à la rupture devra être au minimum de 2200kg pour une corde de type A et 1800kg pour une corde de type B.
La limite de ce test :
La limite de ce test est que jamais en utilisation normale on ne pourra atteindre ces valeurs car ne l’oublions pas, le système d’arrêt de chute (EN 355, ou EN 353) permet de limiter la force à 600kg avec une masse de 100kg.
Néanmoins ces valeurs (et même une rupture) peuvent s’atteindre si dans un autre usage que l’accès sur corde, cette dernière est utilisée par exemple pour tendre une tyrolienne ou lever des charges lourdes.
On notera tout de même que dans le cas où on effectue une traction sur une corde semi-statique jusqu’à la limite de sa rupture, son allongement sera proche de 40% !
Mesure de la résistance de la corde semi-statique avec terminaison en boucle :
Ce test mesure la résistance statique d’une corde semi-statique munie d’une terminaison.
Cette terminaison en boucle peut être, nouée, cousue, sertie, ou épissurée.
Comment est mesuré la résistance d’une corde avec terminaison selon la norme EN 1891 ?
Sur un brin de corde semi statique, on testera les terminaisons nouées qui restent le cas la plus défavorable. On fera un œil avec un nœud en 8 sur chacune des extrémités et on tirera sur chaque extrémité simultanément à la limite de la rupture de la corde.
La résistance de la corde devra atteindre au bout de 3mn au moins 1500kg pour une corde de type A et 1200kg pour une corde de type B.
Pour une corde avec terminaison cousue ou sertie, le test est identique et les résultats sont souvent meilleurs, car le nœud affaibli plus la corde qu’une terminaison cousue ou sertie bien réalisée.
La limite de ce test :
La limite de ce test est que jamais en utilisation normale on ne pourra atteindre ces valeurs car ne l’oublions pas, le système d’arrêt de chute (absorbeur d’énergie EN 355 ou antichute mobile EN 353) permet de limiter la force maximum à 600kg avec une masse de 100kg.
Néanmoins ces valeurs (et même une rupture) peuvent s’atteindre si dans un autre usage que l’accès, la corde est utilisée par exemple pour tendre une tyrolienne ou lever des charges lourdes.
On notera son allongement proche de 40% dans le cas où on effectue une traction sur une corde semi-statique jusqu’à la limite de sa rupture.
Mesure de la force de choc d’une corde semi-statique :
Ce test mesure le choc maximum que vous allez ressentir si vous chutez directement (sans absorbeur d’énergie ni antichute mobile) sur une corde semi-statique EN 1891.
Comment est mesuré la force de choc d’une corde selon la norme EN 1891 ?
On suspendra sur un brin de corde semi-statique de 2 mètres, muni à chaque extrémité d’un nœud en 8, une masse de 100kg pour une corde de type A et 80kg pour une corde de type B.
On remonte la masse de 30cm puis on la lâche dans le vide (soit l’équivalent d’une chute de facteur 0.3).
La force générée après absorption de l’énergie due à l’allongement de la corde ne doit pas excéder 600kg pour une corde de type A comme pour une corde de type B.
En effet la force de choc qu’un opérateur de 100kg (avec le matériel) peut supporter sans dommage est au maximum de 600kg.
C’est pourquoi les systèmes antichute (absorbeur d’énergie EN 355 ou antichute mobile EN 353) sont conçus pour limiter l’effet de la chute à 600kg en cas de chute avec facteur supérieur à 0,3.
La limite de ce test :
En théorie on ne peut pas tomber directement sur une corde semi-statique, car la réglementation impose l’usage d’un système d’arrêt de chute (absorbeur d’énergie EN 355 ou antichute mobile EN 353), la corde semi statique n’étant qu’un support flexible d’assurage.
Mesure du nombre de chutes d’une corde semi-statique :
Ce test mesure la performance dynamique d’une corde semi-statique lors de chutes répétées.
Comment est mesuré le nombre de chute d’une corde selon la norme EN 1891 ?
On suspendra sur un brin de corde semi-statique de 2 mètres muni à chaque extrémité d’un nœud en 8, une masse de 100kg pour une corde de type A et 80kg pour une corde de type B.
On remonte la masse de moitié jusqu’au point d’ancrage (1mètre) puis on la lâche dans le vide (soit l’équivalent d’une chute de facteur 1)
Ce test est répété 5 fois (avec 5mn de repos entre chaque essai).
La corde doit au moins résister à 5 chutes que ce soit une corde de type A ou B.
La limite de ce test :
Dans ce test, certes la corde ne cassera pas, même après une chute de facteur 1, mais avec un tel facteur de chute, la force de choc sera tellement élevée que le corps de l’opérateur ne s’en sortirait pas indemne.
Utilisez toujours des systèmes antichute prévus pour restituer au corps l’effet d’une chute de facteur 0,3 !
Autre paramètre non mesuré par la norme : la résistance à l’abrasion d’une corde semi-statique ?
La résistance de la gaine est subjective, elle dépend de beaucoup de paramètres :
- le taux d’hygrométrie (plus une corde est humide moins elle résiste à l’abrasion)
- l’état d’usure des appareils (un bloqueur neuf va plus endommager une corde)
- l’environnement dans lequel évolue l’opérateur (poussière, peinture, ciment, soleil…)
- la souplesse ou la rigidité de la corde (on l’a dit plus haut, une corde rigide résistera mieux à l’abrasion qu’une corde souple)
Néanmoins quelques points peuvent être factuels :
-le diamètre de la corde : plus le diamètre est fin, moins la corde résistera à l’abrasion (une corde de 11mm sera plus résistante qu’une 10.5, car elle aura plus de surface de frottement)
-L’épaisseur de la gaine de la corde est aussi très importante.
Si le pourcentage de gaine minimum requis par la norme EN 1891 est de 33% (à l’exception des cordes d’élagage qui ont une construction très particulière), chaque fabricant peut, selon certaines technologies choisies, augmenter cette épaisseur de gaine et ainsi augmenter, sa résistance à l’abrasion.
Spécificités des cordes d’élagage EN 1891
Il existe 2 types de corde d’élagage :
- la corde d’accès/secours pour rejoindre le point haut de l’arbre et gérer depuis le sol une éventuelle évacuation de l’élagueur par l’homme de pied.
-la corde de rappel appelée également corde à grimper. C’est, LA corde symbolique des élagueurs, spécialement développée pour leur activité. Historiquement on l’avait nommée corde « américaine ».
Comment sont construites les cordes de rappel pour l’élagage ?
Les cordes d’élagage doivent êtres très souples pour pouvoir être contraintes facilement par un nœud autobloquant textile appelé également Prusik.
En effet, l’élagueur se déplace en phase de travail le long de la corde de haut en bas de l’arbre. Il se freine à l’aide du Prusik, allant jusqu’à le bloquer sur la corde en « l’étranglant ».
Pour que la corde d’élagage puisse se « tordre » facilement, il fallait une corde très souple et molle.
Par ailleurs l’élagage est une activité qui sollicite beaucoup les cordes à cause de la friction importante sur l’anneau de la fausse fourche, mais aussi sur les branches de l’arbre et entre la gaine de la corde et la gaine du Prusik textile.
Par conséquent une corde de fort diamètre donc résistante à l’abrasion est nécessaire, d’autant plus que pour mieux piloter le Prusik, il faut que lui-même soit d’un diamètre important. Sachant que la corde de rappel doit toujours être d’un diamètre supérieur à celui du nœud autobloquant, les premières cordes de rappel étaient d’un diamètre de 13 mm et la cordelette qui composait le Prusik, elle de 10,5 à 11mm.
La gaine du Prusik est composée d’un assemblage de fils polyester rouge et d’aramide
Afin de réaliser une corde semi-statique possédant toutes ses caractéristiques, théoriquement incompatibles (un gros diamètre ne peut pas donner une corde souple…) les fabricants européens se sont inspirés des USA, où l’élagage était très développé. Ainsi sont nées les cordes d’élagage à « construction américaine »
Qu’est-ce que la construction « américaine » ?
Sur une corde de type « américaine », on va mettre une gaine très épaisse, pouvant parfois atteindre jusqu’à 70% du poids total de la corde, donc avec très peu d’âme pour gagner en souplesse.
Toute fois c’est dans la construction de la gaine que tout va se jouer, puisqu’habituellement une gaine de corde semi-statique est composées de 32, 40 ou encore 48 fils retordus ensembles de faibles épaisseurs qui sont tressés autour de l’âme.
Pour la construction « américaine » on ne va utiliser que 16 fils (ou fuseaux), mais extrêmement épais. Tellement épais qu’un nouveau process d’assemblage et de retordage est utilisé : le « guipage ». Il rend ce fil presque aussi gros qu’une cordelette !
Corde d’élagage 16 fuseaux guipés corde classique 32 fuseaux
En effet, plus il y a de fils (appelés également « fuseaux » du nom de leur support sur le métier à tresser), plus ils vont se rigidifier en se rétractant à l’usage et à l’humidité.
Cette gaine ainsi construite sans trop la serrer sur l’âme, rend la corde d’élagage souple et relativement molle pour facilement être contrainte par un Prusik textile.
Mais comment conserver la souplesse de cette corde semi-statique à l’usage et à l’humidité ?
La solution est de tresser une gaine en polyester qui a une rétraction limitée. La plupart des fabricants utilisent maintenant du fil polyester pour la construction de leur gaine.
En plus cela tombe bien puisque l’autre problème à résoudre était l’échauffement de la gaine de la corde au passage sous tension du nœud autobloquant Prusik lors du déplacement de l’élagueur à la descente. Cet échauffement va jusqu’à brûler la gaine de la corde si elle est en polyamide (point de fusion 230°). En revanche le point de fusion du polyester est de 255° et ne sera pas atteint lors d’une descente même avec un Prusik textile composé lui-même d’un assemblage intimement mélangé de polyester et d’aramide (point de destruction de 500°).
Cette construction en 16 fuseaux permet également de faire des épissures, ce qui est beaucoup plus complexe avec les cordes semi-statiques de construction classique en 32 fuseaux et plus.
Plus récemment, l’arrivée sur le marché d’autobloquants mécaniques, comme le Petzl Zig-Zag, a fait évoluer les cordes vers la diminution des diamètres, mais sans changer fondamentalement pour autant le type de construction des cordes de rappel des élagueurs.
Comment sont construites les cordes d’accès/secours en élagage ?
Soit elles sont construites comme des cordes de rappel mais utilisées à simple (technique SRT : Single Rope Technic)
Soit elles sont construites comme une corde semi-statique classique, mais avec un diamètre souvent supérieur à 11mm pour mieux résister à l’abrasion et s’adapter aux différents bloqueurs qui permettent de la parcourir. Mais aussi leur élasticité doit être relativement faible afin de limiter au maximum l’effet yoyo lors des nombreuses remontées sur corde que cette dernière devra subir.
Comportement des cordes semi-statiques d’accès/secours en élagage :
Lors de la fabrication des cordes semi-statiques, les fabricants mettent un apprêt sur les fils composants la gaine, afin de faciliter leur passage dans les différents guides des machines à tresser, c’est une sorte de lubrifiant et cet additif rend glissant la corde lors des premières utilisations. Vous pouvez être surpris lors de son premier usage notamment si vous utilisez un frein déjà un peu usé. La solution, reste de tremper la corde semi-statique 24h dans un bac pour rincer ces lubrifiants avec ensuite un séchage éloigné d’une source de chaleur et du soleil.
Il y a une autre raison de tremper sa corde avant usage du fait de leur construction majoritairement en polyamide. Il est important de rappeler le comportement du polyamide (et dans une moindre mesure du polyester) à l’usage et ses conséquences.
Le polyamide s’il s’allonge très bien, a comme inconvénient de se rétracter à l’usage notamment en présence d’humidité (il y en a beaucoup dans l’air), voici les conséquences :
-si le polyamide se rétracte, cela entraine une variation de sa longueur et la corde va se raccourcir (jusqu’à 10%), ce qui peut poser un problème si elle a été coupée à une longueur précise. Par conséquent la tremper avant la découpe est une solution.
-si le polyamide se rétracte, le diamètre de la corde va également grossir légèrement et donc changer vos sensations dans le passage des différents appareils de sécurité.
-la rétraction du polyamide affecte également la souplesse des cordes semi-statiques, elles deviennent dures à manipuler et à plier, par conséquent elles sont aussi de moins en moins aisées à nouer dans le temps.
-Pour finir, une corde qui se rétracte à l’humidité aura un allongement légèrement supérieur à l’allongement d’origine.
En résumé, le durcissement d’une corde semi-statique majoritairement fabriquée en polyamide est inéluctable. En revanche une corde semi-statique qui durcit est une corde qui résistera mieux à l’abrasion dans le temps. C’est sa rigidité qui permettra l’amélioration de cette performance.
ATTENTION : le résumé de cette norme ne contient pas tous les détails de la norme.
C’est une simplification des principaux essais et exigences de la norme.
Pour plus de précisions et informations consultez la norme directement auprès de l’AFNOR.








